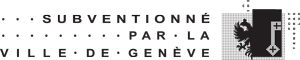Transition et démarches médicales
Les explications données ci-dessous se basent, d’une part sur l’idée vous souhaitez aligner partiellement ou totalement vos caractéristiques physiques à votre genre ressenti, et d’autre part sur les situations médicale et juridique existantes actuellement (fin 2017) en Suisse.
La situation actuelle n’est pas satisfaisante selon nous, mais il faut faire avec aujourd’hui, raison pour laquelle d’une part nous donnons des indications par rapport à cette situation, et d’autre part, nous formulons une opinion séparée en conclusion.
Généralités
La décision de faire votre transition, tout comme les modalités pour la faire, sont des questions hautement personnelles. Juridiquement, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a indiqué à plusieurs reprises, et encore récemment, qu’un État ne pouvait contraindre une personne trans* à subir des traitements hormonaux, encore moins des opérations, pour être reconnue dans son genre ressenti par l’état civil. Il en va de même de certains tribunaux cantonaux suisses, notamment à Genève et dans le canton de Vaud.
Le chemin médical choisi est donc votre décision basée sur vos propres besoins et attentes de votre expression de genre. Le Forum médical suisse a publié en 2014 un article relevant qu’une transition réussie était un chemin personnel discuté et préparé avec le psychiatre et les autres professionnels de la santé.
Nous vous recommandons vivement de lire les Standards de soins pour personnes transgenres publiés par la « World Professional Association for Transgender Health » afin de mieux comprendre les différents traitements possibles et leurs effets positifs et négatifs avant de vous déterminer. Il peut également être utile de partager ce document avec votre médecin généraliste.
La version 7 des standards de soins (SDS 7) – actuellement en révision – représente la norme à prendre en compte par les praticiens sérieux qui s’occupent de la santé des personnes transgenres (voir la page dédiée de notre site internet). Elle existe en 16 langues différentes.
Suivi psychologique
Depuis mai 2010, la WPATH demande à ce que les questions de non-conformité de genre ne soient plus considérées comme une maladie mentale répertoriée au DSM-V de l’American Psychiatric Association (APA) ou dans la Classification Internationale des Maladies (CIM) de l’OMS. Malheureusement cette demande n’a pas encore eu d’effet et toute démarche médicale commence par une appréciation psychiatrique plus ou moins longue. La durée minimum de six mois exigée par certains psychiatres ne ressort pas des SDS 7, mais des critères de l’APA pour le diagnostic de dysphorie de genre. De nombreux psychiatres estiment toutefois que la diagnostic peut être posé plus rapidement suivant le parcours de vie du/de la patient.e.
Le suivi psychiatrique peut être réalisé par un.e psychologue qui agit par délégation du médecin psychiatre qui supervise son activité, ce qui permet la prise en charge par l’assurance de base, ou directement par un psychiatre. La fréquence des réunions varie en fonction de vos besoins.
Même si la classification de la dysphorie de genre comme maladie mentale et l’obligation de suivi psychologique peuvent être perçues comme vexatoires et dégradantes, le soutien et les renseignements apportés par le/la psychologue/psychiatre sont souvent très utiles dans une période de fortes émotions et de questionnement personnel profond. Le/la psychologue/psychiatre pourra également aiguillier vos proches qui en exprimeraient le besoin, soit vers des consœurs ou confrères, soit vers des associations aptes à les aider car il ne faut pas sous-estimer l’impact de votre transition sur les personnes qui vous sont le plus proche (époux-se, compagnon-compagne, enfants, parents…).
Lorsque le/la psychiatre
i) aura constaté l’existence d’une dysphorie de genre,
ii) sera convaincu.e qu’il n’existe pas de contre-indications psychiatriques (c.-à-d. autres troubles psychiatriques graves non stabilisés) et
iii) sera convaincu.e de votre capacité de discernement,
il/elle établira les attestations nécessaires pour commencer les traitements dont vous aurez parlé avec lui/elle, traitements visant à réduire la souffrance issue de l’inadéquation de votre corps, ou d’une partie de celui-ci, à votre genre ressenti.
À notre avis, les demandes de traitement à adresser à l’assurance maladie devraient toujours être faites par le psychiatre car c’est lui le médecin traitant la dysphorie.
C’est également une attestation de ce type qui servira de base à la demande de changement d’état civil.
Démarches MtF
Hormonothérapie
Selon les SDS 7, il est important de souligner qu’avant de débuter le traitement hormonal, le psychiatre et/ou l’endocrinologue doivent vous proposer de conserver votre capacité de reproduction, donc de faire congeler du sperme. En effet, le traitement hormonal aura rapidement pour effet de vous rendre stérile, stérilité qui durera aussi longtemps que le traitement est suivi ou pour toujours après l’opération de réassignation.
Nous déconseillons absolument la prise d’hormones achetées sur internet par automédication. En Suisse, une telle pratique est illégale et ressort du droit pénal. Mais elle est surtout dangereuse pour la santé.
L’endocrinologue commence en principe le traitement par un bilan sanguin afin d’une part d’établir qu’il n’existe pas de contre-indications à la prise d’hormones, et d’autre part de déterminer vos taux hormonaux, chaque être humain produisant à la fois des hormones féminines et des hormones masculines.
Dans le cas d’une transition homme vers femme, le traitement vise à augmenter le taux d’œstrogènes, voire si désiré celui de progestérone, et à faire chuter le taux de testostérone (inhibition de la testostérone). La simple prise d’œstrogènes contribue déjà à la chute du taux de testostérone, mais un anti-androgène est souvent prescrit pour accélérer les effets du traitement.
La progestérone est une hormone qui peut être prise en complément des œstrogènes, soit pour faire baisser le taux de testostérone en l’absence de prise d’anti-androgène, soit pour favoriser la répartition des graisses et le développement de la poitrine, soit pour améliorer la texture de la peau.
Il existe des traitements par voie orale, par voie cutanée (gel ou patch) ou encore par injection. Il est important d’en discuter les avantages / inconvénients, notamment sur le foie, avec l’endocrinologue, tout comme les dosages à respecter strictement.
La prise d’œstrogènes dure en principe toute la vie, même si elle se réduit après une éventuelle réassignation, alors que les anti-testostérones ne sont plus utiles après cette dernière.
Les effets des traitements hormonaux sont variables en fonction de chaque individu, notamment de leur âge, et prennent du temps. Globalement, il faut compter environ six mois de prise d’œstrogènes pour constater des effets sur la poitrine et la redistribution de la masse graisseuse, alors que la disparition de la testostérone induit une baisse assez rapide de la libido. Ces effets, ainsi que leur délai d’apparition, sont détaillés dans les SDS 7.
L’endocrinologue procédera au minimum tous les six mois à des contrôles sanguins avant les éventuelles opérations de réassignation, puis tous les ans une fois la réassignation réalisée.
Épilations
La diminution, puis la suppression, de la testostérone ne fait malheureusement pas disparaître les poils chez les individus nés homme. Vous voudrez donc sans doute supprimer définitivement la pilosité typiquement masculine des zones comme la barbe, le thorax, les fesses et les jambes.
La seule technique définitive prise en charge par les caisses maladie est l’épilation au laser faite sous le contrôle d’un dermatologue. Cette technique implique une peau claire et un poil foncé. Elle ne fonctionne donc pas pour les personnes blondes, pour les personnes de couleur ou encore sur les poils blancs des personnes un peu moins jeunes. Dans ce cas, il faut pratiquer à vos frais l’épilation par électrolyse consistant à faire passer un courant électrique dans le bulbe du poil pour le brûler. Cette technique est également beaucoup plus lente que l’épilation au laser.
Si la prise en charge par les caisses maladie de l’épilation du visage ne pose en principe pas de problème, il n’en va pas de même pour les autres zones du corps dont la pilosité est pourtant une caractéristique sexuelle secondaire de l’homme par rapport à la femme. Certaines caisses essaient, en tout cas dans un premier temps, de refuser l’épilation définitive du thorax, des fesses ou des jambes. Il faut insister.
Voix
Le traitement hormonal n’a aucun effet sur la voix des hommes ayant déjà mué. Pour ceux qui le désirent, il faut donc travailler la voix afin de lui donner davantage de féminité. Ce travail, fait avec un.e phoniatre ou logopédiste, prend du temps et nécessite de beaucoup s’exercer. Il est pris en charge par la caisse maladie s’il est prescrit par le psychiatre et/ou un médecin ORL.
Une voix féminine n’est pas caractérisée que par un timbre plus aigu, mais aussi par des intonations différentes, plus de douceur dans la prononciation, plus de variation entre les graves et les aiguës et une résonance qui se fait davantage dans l’espace pharyngé que dans la cage thoracique.
Une bonne coordination respiratoire est aussi indispensable.
Il est possible de se faire opérer des cordes vocales. Nous ne connaissons pas de cas à l’Association 360 et serions heureux de rencontrer une ou des personnes ayant subi ce type d’intervention (lynn@espace360.ch).
Cheveux
Pour les femmes trans* souffrant de calvitie, partielle ou totale, l’assurance invalidité doit prendre en charge les frais d’une perruque médicale par année. Ces perruques doivent être acquises auprès d’un perruquier ayant l’habitude de travailler avec les milieux médicaux, souvent avec des personnes souffrant des effets secondaires des traitements de chimiothérapie. Les expériences qui nous ont été rapportées à Genève n’ont pas été très positives quant à l’accueil de femmes trans* en début de transition.
Une autre solution, si elle est possible pour vous, est de faire procéder à une autogreffe de cheveux. Il existe deux techniques de base.
La technique de prélèvement de bandelettes (FUT) dans la zone dans laquelle la densité des cheveux est élevée et leur incision dans la zone de faible densité. Cette technique, assez ancienne, laisse de grandes cicatrices sur le cuir chevelu, cicatrices toutefois cachées par les cheveux. Elle permet par contre de transplanter plus de cheveux en moins de temps.
La technique de prélèvement et greffe racine par racine ou FUE est la technique la plus récente. Là également, il s’agit de prélever des cheveux dans la zone à forte densité puis de les implanter dans la zone à faible densité. Pour une greffe d’environ 6’000 cheveux, il faut compter environ 10 heures d’opération sous anesthésie locale d’une vingtaine d’injections dans le cuir chevelu.
Dans les deux cas, suivant la densité et les zones à greffer, il est possible que la tête doive être totalement ou partiellement rasée. Il faut compter environ 6 mois pour commencer à voir les effets en général bons, voire très bons. Et le résultat final est atteint après 18 à 24 mois.
La calvitie est une caractéristique masculine dont la correction devrait être prise en charge par l’assurance obligatoire de soins au titre de correction des caractères sexuels secondaires lorsqu’elle participe à la souffrance engendrée par la dysphorie. Malheureusement, nous ne connaissons pas de femme trans* qui ait demandé ce remboursement.
En effet, il est possible de faire cette intervention dans de bonnes conditions à l’étranger pour des coûts variant entre 2’000.— et 4’500.— francs suisses selon le nombre de greffons à transplanter.
Depuis peu, la technique FUE peut être pratiquée par un robot qui atteint des densités de cheveux encore plus importantes dans un temps nettement réduit. Cette technique est encore très onéreuse.
Chirurgies
Encore une fois, les chirurgies ne sont pas obligatoires pour être reconnu.e.s dans son genre ressenti. C’est votre choix à discuter avec votre psychiatre, puis avec le chirurgien que vous aurez choisi. Il faut être conscient, premièrement que vous allez faire faire des interventions sur un corps en bonne santé, et de l’autre que toute chirurgie comporte des risques que vous devez mesurer et comprendre.
Il n’y a pas de base légale, ni de jurisprudence, qui impose une durée minimale de suivi psychiatrique ou hormonal avant d’entreprendre les opérations qui vous jugerez nécessaire à réduire votre souffrance. L’essentiel est de préparer votre transition – votre « voyage » – de manière cohérente avec le corps médical qui vous suit.
Trois hôpitaux universitaires pratiquent en Suisse les chirurgies de réassignation MtF et les augmentations mammaires (Bâle, Lausanne et Zürich). À notre connaissance, seul Zürich pratique la FFS à l’heure actuelle.
Les augmentations mammaires seules peuvent être faites dans d’autres hôpitaux, à Genève aux HUG par exemple.
La WPATH relève que les opérations ont un fort effet bénéfique sur la santé des personnes trans* en améliorant leur bien-être et leur intégration.
FFS (Full facial surgery)
Ces chirurgies visent à corriger des traits typiquement masculins du visage et de la tête tels que la pomme d’Adam (cartilage thyroïdien), la forme carrée du menton, les arcades orbitaires et l’os de la glabelle, l’abaissement de la ligne des cheveux ou encore la forme du nez.
Pour être prises en charge par l’assurance obligatoire, il faut que ces chirurgies soient prescrites par le psychiatre qui doit attester qu’elles seront efficaces à réduire la souffrance induite par la dysphorie.
Le chirurgien doit confirmer qu’elles sont techniquement possibles dans votre cas.
AM (Augmentation mammaire)
Le traitement hormonal permet le développement de petits seins allant rarement au-delà d’un bonnet AA, voire A, même après deux ans d’hormonothérapie.
Pour de nombreuses femmes trans*, mais pas pour toutes, une toute petite poitrine ne correspond pas du tout à l’image qu’elles ont d’elles-mêmes et une augmentation mammaire fait partie intégrante de leur parcours. Le Tribunal fédéral n’a jamais posé de critères liés à un phénotype à respecter pour la prise en charge par l’assurance de base. Au contraire, il parle d’aider la patiente à construire l’image qu’elle a d’elle-même pour réduire sa souffrance.
Quand elle est désirée et qu’une réassignation des caractères primaires est également prévue, l’augmentation mammaire a lieu simultanément avec la SRS, ce qui permet une seule narcose. Mais ce n’est pas une obligation. Il peut exister des raisons médicales ou psychologiques à séparer les deux opérations.
Le choix des prothèses et les techniques à appliquer sont à discuter avec le chirurgien, qui, s’il est bon, pourra vous proposer plusieurs alternatives, tant pour les prothèses que pour la technique utilisée.
Le choix des prothèses, outre leur taille, porte également sur leur forme, ronde ou en poire. Dans ce dernier cas, trois paramètres entrent en ligne de compte (profondeur, largeur, hauteur).
Les prothèses peuvent être implantées par le mamelon, par le dessous du sein ou encore par les aisselles. Cette dernière technique ne laisse pas de cicatrices visibles car elles sont sous les bras, mais nécessite l’emploi d’une grosse seringue qui rend la pose de l’implant moins précise et plus délicate. L’implant est alors fortement comprimé lors de la pose et certains fabricants annulent la garantie de dix ans lorsque cette technique est utilisée.
Il existe également des techniques de transfert de graisses, de la zone abdominale par exemple, qui peuvent également être utilisées, seules ou en complément des implants.
La musculature typiquement masculine peut jouer un grand rôle sur le choix des techniques et sur le résultat final. Il est important de pouvoir en discuter avec le chirurgien.
SRS
La réassignation des caractères sexuels primaires consiste en une pénectomie (ablation du pénis), une orchidectomie (ablation des testicules), une vaginoplastie (construction du vagin) et une clitoroplastie (construction d’un clitoris). Ces opérations ont lieu simultanément.
La peau et le gland du pénis sont utilisés dans la construction des petites lèvres, du vagin et du clitoris. Certains chirurgiens utilisent aussi la peau du scrotum pour réaliser les grandes lèvres et parfois agrandir le vagin.
Globalement, il existe deux techniques pour construire le vagin. L’une consiste à « inverser » la peau du pénis évidé, peau qui servira à construire le vagin. On parle d’inversion pénienne. L’autre consiste à prélever un bout du colon (partie de l’intestin) qui servira alors de cavité vaginale.
L’inversion pénienne à l’avantage de ne pas toucher à l’intestin, ce qui évite d’opérer un organe en bonne santé. C’est un facteur à prendre en compte dans le choix que vous ferez. La taille du pénis est importante pour obtenir un néovagin de taille normale. Si la personne à opérer a été circoncise, obtenir de bons résultats avec l’inversion pénienne est compliqué en raison de l’absence de la peau du gland.
L’utilisation du colon implique l’intervention d’un chirurgien viscéral qui travaille de concert avec le plasticien. L’opération dure un peu plus longtemps que l’inversion pénienne. Comme le bout du colon est déplacé avec son système d’irrigation sanguine, le néovagin a moins de risques de se nécroser et de rétrécir avec le temps. Il est possible également qu’il y ait quelques sécrétions, utiles comme lubrifiant lors de la pénétration, mais qui peuvent avoir parfois une odeur désagréable.
Avec les deux techniques, il faut pratiquer des exercices de dilatation afin de garantir la taille du néovagin à long terme. La durée et la fréquence de ces exercices dépendent de la technique utilisée et des résultats opératoires. Mais il faut compter au minimum une pratique quotidienne de 20 à 30 minutes durant au moins six mois. Puis, pour le reste de la vie, une à deux dilatations hebdomadaires sont nécessaires pour que le néovagin conserve sa taille originale.
La durée d’hospitalisation varie de 7 à 10 jours, puis il faut compter encore 4 à 6 semaines d’arrêt de travail, semaines durant lesquelles une à trois consultations hebdomadaires sont nécessaires pour le suivi postopératoire et la mise en place des exercices avec l’aide du personnel infirmier spécialisé.
Les 4-5 premiers jours après l’opération sont des jours de « lit strict », c’est-à-dire sans vous lever. Après le premier changement de pansement qui a lieu à la fin de cette période, le chirurgien décide si vous pouvez vous lever et à quelle fréquence.
Il faut également compter plusieurs semaines durant lesquelles l’utilisation d’un coussin spécial pour s’asseoir est nécessaire, au début même pour une courte durée. Il est nécessaire d’attendre 3 semaines environ après l’opération avant de pouvoir prendre le train ou l’avion, ou conduire, pour une durée de plus d’une heure.
Une durée de 3 mois est nécessaire avant de reprendre le sport intensif ou la natation. Il en va de même pour une activité sexuelle avec pénétration vaginale.
Quelle que soit la technique utilisée, ces opérations comportent des risques qu’il faut discuter avec les chirurgiens. Les principaux sont liés à des problèmes urinaires puisqu’il y a intervention sur l’urètre ou à l’apparition d’une fistule entre le néovagin et la cavité abdominale.
Tous ces points sont à approfondir avec le chirurgien et le personnel infirmier avant de vous faire opérer afin de bien comprendre les risques et les contraintes engendrés par ces opérations. Les SDS-7 souligne que des opérations réussies dépendent de l’équipe qui vous prend en charge, alors n’hésitez pas à exiger de rencontrer également les infirmières qui s’occuperont de vous. N’hésitez pas à demander également des statistiques sur les résultats, les échecs et le nombre d’opérations qui ont dû être refaites une ou plusieurs fois. Et ce quel que soit l’endroit où vous pensez vous faire opérer.
Démarche FtM
Hormonothérapie
Selon les SDS 7, il est important de souligner qu’avant de débuter le traitement hormonal, le psychiatre et/ou l’endocrinologue doivent vous proposer de conserver votre capacité de reproduction, donc de faire congeler des ovocytes.
Nous déconseillons absolument la prise d’hormones achetées sur internet par automédication. En Suisse, une telle pratique est illégale et ressort du droit pénal. Mais elle est surtout dangereuse pour la santé.
L’endocrinologue commence en principe le traitement par un bilan sanguin afin d’une part d’établir qu’il n’existe pas de contre-indications à la prise d’hormones, et d’autre part de déterminer vos taux hormonaux, chaque être humain produisant à la fois des hormones féminines et des hormones masculines.
Le traitement hormonal d’un homme trans* (FtM) consiste essentiellement à la prise de testostérone, soit sous forme de gel, soit par injection trimestrielle.
Les effets principaux du traitement sont l’aggravation de la voix, l’augmentation de la taille du clitoris (variable), l’augmentation de la pilosité faciale et corporelle, l’arrêt des menstruations, l’atrophie des tissus mammaires et une baisse du pourcentage de graisse corporelle par rapport à la masse musculaire. Une augmentation de la libido est également souvent constatée. Ces effets, ainsi que leur délai d’apparition, sont détaillés dans les SDS 7.
Le traitement se prend, comme les œstrogènes chez les personnes MtF, durant toute la vie.
Chirurgies
Encore une fois, les chirurgies ne sont pas obligatoires pour être reconnu.e.s dans son genre ressenti. C’est votre choix à discuter avec votre psychiatre, puis avec le chirurgien que vous aurez choisi. Il faut être conscient.e, premièrement que vous allez faire faire des interventions sur un corps en bonne santé, et de l’autre que toute chirurgie comporte des risques que vous devez mesurer et comprendre. Cela est d’autant plus vrai pour certaines chirurgies FtM dont la complexité est très élevée et donc dont le taux de complications postopératoires l’est également.
En Suisse, seuls l’hôpital universitaire du canton de Bâle et le CHUV à Lausanne pratiquent les opérations de réassignation des caractères sexuels primaires des hommes trans*.
Pour les hommes trans* la première chirurgie consiste en une ablation complète de la poitrine (mastectomie) avec éventuellement la création d’une poitrine d’allure plus masculine par implants pectoraux.
Un deuxième type d’opération consiste à l’ablation de l’appareil génital par hystérectomie totale ou partielle, complétée d’une ovariectomie et la reconstruction de la partie fixe de l’urètre.
Les opérations précitées peuvent être combinées avec une métoïdioplastie – utilisation du clitoris hypertrophié sous l’effet des hormones comme (petit) pénis – ou une phalloplastie qui consiste à créer un néopénis par prélèvement de tissu d’un site donneur (avant-bras, jambes) et extension de l’urètre.
La phalloplastie peut être complétée ultérieurement – minimum 6 mois d’attente – par la pose d’une prothèse érectile.
La métoïdioplastie, ou la phalloplastie, sont généralement combinées avec la vaginectomie (ablation du vagin) et une scrotoplasie (création d’un scrotum par utilisation des grandes lèvres) et la pose d’implants testiculaires.
La durée d’hospitalisation est d’environ 14 jours durant lesquels vous urinerez à l’aide d’une sonde qui sera retirée avant le retour chez vous. Il faut compter 4 à 6 semaines avant la reprise du travail et 2 à 3 mois avant d’avoir des rapports sexuels ou de pratiquer du sport.
Il est très important de vous renseigner sur les risques, notamment urinaires, et les conséquences de ces opérations avant de prendre votre décision.
Prise en charge dans le cadre de la LAMal (Assurance obligatoire de soins ou AOS)
Depuis 1994, les opérations de correction des caractères sexuels primaires et secondaires sont à la charge de l’assurance obligatoire de soins dans le cadre du traitement de la dysphorie de genre. Il en va de même pour les traitements psychiatriques, hormonaux, de la voix et dermatologiques.
La réalité montre cependant que ces prises en charge sont très souvent combattues par les caisses maladie, notamment les opérations chirurgicales. Pour ces dernières, seule la chirurgie de réassignation des caractères sexuels primaires semble ne pas poser, en général, de problèmes. Pour les autres opérations il en va différemment et les caisses utilisent toujours les mêmes arguments pourtant réfutés depuis longtemps par le Tribunal fédéral (TF).
Le premier argument utilisé est celui de l’aspect esthétique. Selon les caisses, la correction des caractères sexuels secondaires s’apparente à de la chirurgie esthétique non remboursée. Le TF a, à de nombreuses reprises, souligné que ce n’était pas le cas dans le cadre du traitement de la dysphorie de genre lorsque le médecin psychiatre et le chirurgien indiquaient que le traitement était approprié pour soulager la souffrance psychique de la personne trans*. Dans ce cas, le traitement est alors réputé être approprié, efficace et économique.
Le deuxième argument souvent avancé est celui de l’égalité de traitement avec les personnes cisgenres. Ainsi la pose d’une pompe érectile ou l’augmentation mammaire n’étant pas remboursées à des personnes cisgenres, elle ne devrait pas l’être à un personne transgenre. Là également le TF a débouté l’assureur qui s’était prévalu de cet argument en soulignant que les situations d’une personne cisgenre et d’une personne transgenre n’étaient pas comparables et qu’en conséquence le principe d’égalité ne pouvait pas s’appliquer.
Les assureurs, pourtant parfaitement au courant de ces décisions déjà anciennes, continuent régulièrement à appuyer leurs refus sur ces arguments. Il ne faut pas baisser les bras face à un premier refus et ne pas hésiter à consulter les associations (ou un avocat si vous en avez les moyens) pour vous défendre.
Assurances complémentaires
La plupart des assurances complémentaires excluent, via leurs conditions générales et les petites lettres en bas de page, la prise en charge des hospitalisations, voire toute prestation qui serait normalement couverte par le contrat, liée à la dysphorie de genre.
Lisez donc attentivement vos conditions générales – dans leur dernière version ! – avant de croire que vous pourrez vous faire hospitaliser en privé ou semi-privé sur la base de votre assurance complémentaire.
Nous pensons que ce type d’exclusion générale préalable, basée sur l’existence de la dysphorie de genre chez un assuré, est clairement transphobe et discriminatoire.
Opinion
Il est important de prendre conscience que la médecine appliquée aux personnes trans* est relativement récente et qu’elle concerne une population très restreinte. En conséquence, il existe peu d’études et publications scientifiques relatives aux diverses prises en charge possibles, notamment sur leurs conséquences à long terme sur la santé en général des personnes trans*. Les résultats des rares études qui existent sont essentiellement publiés à l’étranger.
En Suisse, la plupart des médecins ou du personnel soignant n’ont aucune idée des problématiques trans* en raison de l’absence de formation spécifique dans quelque domaine que ce soit, y compris la psychiatrie*. Il est donc très important de se renseigner auprès des associations afin d’être aiguillé.e.s vers les rares personnes qui, soit se sont formées à l’étranger, soit ont acquis une grande pratique sur le tas. Étant entendu que dans ce dernier cas, le tas, c’est les personnes trans* en Suisse d’il y a quelques années.
(* En Suisse alémanique, un groupe de psychiatres et de psychologues se réunit mensuellement et travaille à faire évoluer les connaissances dans le domaine de la prise en charge de la dysphorie de genre).
Concernant la chirurgie, en raison du peu de cas lié à la taille de la population suisse et au fractionnement fédéraliste des hôpitaux, les chirurgiens peinent à satisfaire les critères posés par la WPATH lors de séminaires pour atteindre un niveau de sécurité et de qualité satisfaisant. Un rapport publié en 2015 à la demande du Tribunal cantonal du canton de Vaud évaluant la situation helvétique a d’ailleurs permis à une femme trans* de faire prendre en charge par l’assurance obligatoire ses opérations réalisées en Thaïlande. Ce rapport relève également l’opacité dont font preuve certains médecins et hôpitaux quant aux statistiques par cas, par type de problème postopératoire rencontré, etc.
En tant qu’association soutenant les personnes trans*, notre propos n’est pas de vous pousser à vous faire traiter ou opérer à l’étranger, mais de vous rendre attentif.ve au fait que la médecine trans* est loin d’être une science exacte, que sa pratique est très limitée en Suisse et que vigilance et exigence devraient vous conduire à redoubler de questions, voire à demander des deuxièmes avis en cas de doute.
Se faire opérer à l’étranger, même dans des pays mondialement reconnus pour leurs compétences dans le domaine (USA, Canada, Thaïlande, Belgique ou Suède), n’est pas sans conséquence non plus car les opérations nécessitent toutes un suivi de longue haleine qu’il n’est pas forcément possible de mener sur place à chaque fois. Les résultats à une année, deux ans, voire davantage, dépendent beaucoup du suivi post-opératoire qui nécessite de connaître les techniques opératoires utilisées, les problèmes éventuels rencontrés par le chirurgien, etc. Assurer un tel suivi en Suisse après une opération réalisée à l’étranger est rarement optimal, parfois impossible.
En plus, la prise en charge par l’assurance obligatoire de soins d’une opération de réassignation réalisée à l’étranger, malgré le jugement vaudois sus évoqué, reste très aléatoire.
Nous pensons que contribuer à élever le niveau de la médecine transgenre en Suisse est le principal défi des associations trans* actuellement.
Lynn